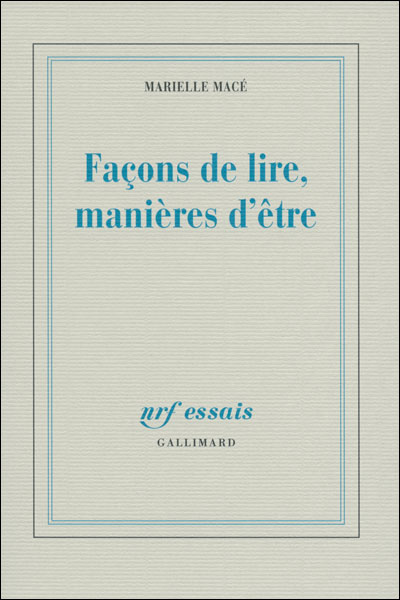M. Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, 2011, 288 p.
Alors qu’il surveillait du coin de l’œil son fils en train de jouer sur un ordinateur, un jeune ami chercheur, étoile montante au firmament du CNRS, me dit un jour : « Moi, je ne lis pas de livres, je ne lis que des articles… J’ai déjà bien du mal à suivre ce qui se produit dans mon secteur… Alors tu comprends… Tous ces gros machins qui auraient pu être résumés en quelques pages… » D’une certaine manière, comme le suggère ce petit coming out intellectuel, l’essai de Marielle Macé vient peut-être déjà trop tard. Défense et illustration de l’expérience que l’on fait quand on lit un livre, de ce qui nous arrive quand on lit un livre, en particulier quand il s’agit de littérature, les changements presqu’imperceptibles comme les bouleversements profonds, il semble appartenir à un passé qui s’enfuit et dont il n’est peut-être déjà qu’une remémoration nostalgique.
On peut aussi se dire, il est vrai, que ce travail montre au contraire que tout n’est pas perdu, que la revendication décomplexée de l’inculture et l’idéologie de l’information qui arment aujourd’hui bien des titulaires de nos institutions de recherche et d’enseignement rencontrent malgré tout des résistances – et cela, à l’intérieur même de ces institutions. Ou que, quel que soit l’état des cerveaux de nos chercheurs et de trop de nos enfants, l’expérience de la littérature reste l’un des biens les plus précieux de l’existence pour les dizaines ou les centaines de millions de personnes qui, tous les jours, ouvrent un roman ou un recueil de poésie. Entre ces deux visions, l’avenir tranchera. Il est sûr en tout cas que l’essai de Marielle Macé constitue à la fois le symptôme d’un problème socio-culturel profond et une prise de position courageuse contre les tenants des data, des données et autres bits d’information – un éloge de la lecture en expérience.
Le témoignage des écrivains
Un autre point fort de cet essai concerne la place qui y est faite aux témoignages de ces praticiens très particuliers de la lecture que sont les écrivains. On sait que certains philosophes, comme Gadamer, ont pu se croire en droit d’écrire des ouvrages entiers consacrés à l’art et à la littérature en refusant ces témoignages et en développant une analyse conceptuelle fondée sur une discussion purement interne à la tradition philosophique. Dans Vérité et Méthode, qui constitue pour certains un modèle insurpassable pour la pensée de l’art, et au-delà du langage et même de l’être, non seulement Gadamer ne donne jamais aucun exemple concret, mais il rejette ostensiblement tous les témoignages venant des artistes eux-mêmes, au motif qu’ils seraient entachés de subjectivisme. Marielle Macé fait, avec justesse, le pari inverse. Ce sont les auteurs, les écrivains, les artistes, lorsqu’ils parlent de leur pratique, qui nous en apprennent le plus sur l’art et la littérature – et non pas les philosophes. Et son livre est, de ce point de vue, une mine d’informations concernant les multiples manières de lire expérimentées par des personnages qui ont également été les inventeurs de nouvelles manières d’écrire, et donc de dire, et donc de vivre.
Une grande partie de l’essai est ainsi composée d’analyses d’expériences de lecture menées par quelques écrivains célèbres du XXe siècle. Proust, Sartre, Michaux, Barthes, Gracq, Paulhan sont tour à tour convoqués, leurs souvenirs et leurs commentaires analysés, afin de montrer ce que chacun d’eux a retiré de sa fréquentation des auteurs qui l’ont précédé, ou plutôt, ce qui de ces lectures a continué à insister parfois tout au long d’une vie, transformant ici le regard et les modes de perception, là les rythmes que l’on donne à sa vie, fixant parfois des formes d’action, parfois des lignes de conduite, transfigurant toujours la prison du passé en une ressource vers une nouvelle forme d’individuation. Pour Marielle Macé, la lecture, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de littérature, est en effet d’abord un engagement. Le lecteur s’engage, mieux : il est engagé, embarqué par ce qu’il lit et il n’en sortira pas indemne. De nos lectures dérivent ainsi des manières de percevoir et d’être mais aussi des manières d’agir, des conduites : « Par la lecture, en elle, les individus se donnent ainsi les formes de leur pratique, et l’expérience littéraire devient une ressource de stylisation de soi. » (p. 23) Ce qui montre, en dépit de ce que croient naïvement les sectateurs de la communication et de l’information, que toute pratique de lecture, surtout si elle est littéraire, a des enjeux éthiques et politiques primordiaux : « Le style est notre “faire”, notre puissance pratique, notre morale, la manière est notre être. » (p. 21)
Linéaments d’une théorie de l’individuation et de la subjectivation par la lecture
Et c’est là le troisième point fort de cet essai. D’exemple en exemple, Marielle Macé esquisse les linéaments d’une théorie de ce qui nous arrive quand nous lisons, de ce que la lecture nous fait, mais aussi des possibilités qui s’ouvrent à nous de nous faire nous-mêmes quand nous lisons. C’est-à-dire d’une théorie de l’individuation par la lecture, prise très justement comme devenir-singulier plus que comme devenir-indépendant, mais aussi d’une théorie de la subjectivation qui ne serait plus confondue, quant à elle, avec le devenir-individu, dans la mesure où elle ouvrirait précisément celui-ci sur les autres et sur le collectif.
Pour rendre compte du développement organisé dont témoigne la première, Marielle Macé propose, en l’empruntant à Montaigne, le concept de « forme-maîtresse », sorte de matrice à la fois formante et formée qui animerait et organiserait les individus-lecteurs en devenir : « Montaigne appelait cela la “forme-maîtresse” : un patron au-dedans, une démarche qui ne nous “exprime” pas forcément, nous attachant à nous-mêmes, qui ne nous “distingue” pas non plus, nous séparant des autres, mais qui nous anime et nous expose en toutes choses. » (p. 21) Cette forme, comme le suggère Proust, constitue pour chaque grand auteur un système à la fois cohérent et singulier, et donc parfois difficile d’accès, mais ce système reste toujours compréhensible, au moins après un temps d’adaptation : « Celui qui avait remplacé pour moi Bergotte me lassait non par l’incohérence mais par la nouveauté, parfaitement cohérente, de rapports que je n’avais pas l’habitude de suivre. » (Proust, cité p. 89)
En ce qui concerne la seconde, Marielle Macé tire également de Proust l’idée que l’individuation produit certes des formes langagières, qui sont comme « l’expression au dehors d’un style d’être, […] le développement verbal d’un mode de présence du moi au monde », mais que la force expressive propre à ces formes, loin de se réduire à l’individu, appelle toujours à des réactualisations toujours nouvelles. Chacune d’entre elles constitue « la formule littéraire généralisable d’une conduite perceptive […] typifiée, c’est-à-dire reconnaissable et généralisable, elle est aussi disponible, elle s’offre à la réappropriation par autrui, au reparcours de ce parcours » (p. 86). Chacune de ces formes possède une force d’expansion à la fois infinie et indéfinie qui fait d’elle une véritable forme-sujet : « proposition attentionnelle, “équipement” pour une différenciation, devenir et puissance, médiation qui s’offre à une généralisation » (p. 86).
Vers la théorie de la manière et du rythme
Marielle Macé en arrive ainsi à identifier le cycle de la production et de la réception littéraire à une circulation de puissances sémantiques à la fois proliférantes et vagabondes : « Le style ici est toujours au carré, pris dans une chaîne de forces, jamais isolé ou inerte. Et la dynamique d’individuation des formes littéraires devient un appel à la nôtre. Qu’y a-t-il au fond de cette expérience ? Décidément pas, de part et d’autre d’une frontière étanche, des sujets et des objets (des personnes et des livres), mais des formes et des manières qui circulent des uns aux autres, les traversent. » (p. 92)
Comme on le voit dans cette dernière citation, ces puissances sémantiques sont identifiées comme « des formes et des manières », selon une idée qui semble empruntée à Proust : « Le lecteur identifie un artiste à un profil perceptif et sensible qui exercera désormais sur lui une influence d’ordre rythmique, comme fit l’écriture de Bergotte pour Marcel en une sorte d’accompagnement intime : “Je chantais intérieurement sa prose”. L’auteur est le nom propre de cette disposition générique devant les choses, ce que Proust appelle une “manière”, qui suscite chez le lecteur la joie d’une conduite de rechercher et, pour ainsi dire, de capture : “Ce qui m’intéressait, c’était non ce qu’ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu’elle était révélatrice de leur caractère ou de leurs ridicules.” » (p. 85)
Et ces manières sont à leur tour souvent décrites comme des « rythmes » : « Peut-être [la dialectique de la vie elle-même] justifie-t-elle entièrement la longueur de la Recherche : elle explique l’invitation récurrente faite au héros d’essayer de nouvelles formes, de nouveaux rythmes, de nouveaux styles, pour rouvrir l’expérience et solliciter cet “être centrifuge” “qu’on est par les beaux jours” (II, 641). » (p. 94)
Ces analyses constituent à mon avis la pointe la plus avancée de la réflexion exposée dans Façons de lire, manières d’être. C’est là que leur auteur rejoint, mais apparemment sans le savoir, un courant de pensée déjà bien développé et qui a depuis longtemps établi la distinction de l’individu et du sujet, l’importance pour l’activité littéraire mais aussi pour le langage ordinaire des phénomènes d’individuation et de transsubjectivation, last but not least le rôle dans ces phénomènes de la manière et du rythme [1].
Le bougé des concepts
Tout cela fait du livre de Marielle Macé un essai salutaire, bienvenu et innovant dans son champ. Il reste toutefois un certain nombre de points que j’aimerais maintenant discuter.
Un premier problème tient au flou des concepts utilisés pour développer cette théorie de la lecture : individu/sujet ; manière/façon ; rythme/tempo. Marielle Macé les confond le plus souvent, glisse de l’un à l’autre comme s’ils étaient équivalents. D’où un certain bougé théorique qui accompagne un texte joliment écrit mais qui cache parfois, sous le vernis brillant du style et de la rhétorique, une certaine imprécision de la pensée.
On a vu que les bases d’une différenciation de l’individuation et de la subjectivation sont présentes et solidement posées sur des exemples tirés des témoignages d’écrivains. Toutefois, dans le discours que l’auteur tient en son nom propre, le sujet est souvent confondu avec l’individu et vice versa. C’est le cas au début du livre : « La lecture est d’abord une “occasion” d’individuation : devant les livres nous sommes conduits en permanence à nous reconnaître, à nous “refigurer”, c’est-à-dire à nous constituer en sujets. » (p. 18) Quelques lignes plus loin : « La lecture est une “allégorie” de l’individuation [….] car une situation d’art est une véritable mise en cause des sujets, à la fois uniques et égaux, communs, répétés. » (p. 18) Ce l’est encore au milieu : « Merleau-Ponty et Leroi-Gourhan aident par exemple à fonder l’individuation sur la question du rythme, sur la rythmicité fondamentale des pratiques individuelles […] La rythmicité est un aspect essentiel de l’institution des sujets. » (p. 159) Ce l’est toujours à la fin de l’ouvrage : « Un sujet n’est peut-être pas l’absolu d’une puissance, c’est à la fois un corps capable et un corps affecté, une force qui se conduit et qui est conduite. Dans la lecture, l’opération du style noue précisément cette activité et cette activité […]. Elle suppose que les individus répliquent à la force qu’une force littéraire exerce sur eux. » (p. 244) Un peu plus loin : « Baudelaire lui a appris [à Barthes] que la majoration d’un “geste” n’altère pas l’individu mais le développe, le révèle à lui-même ; il l’a autorisé à comprendre la subjectivité comme un “artificiel dans sa splendeur”. » (p. 259) Et finalement : « Tout est peut-être là : en régime esthétique, le phrasé original où un sujet semble risquer au dehors l’essentiel de sa singularité. » (p. 263)
La manière, quant à elle, nous l’avons vu, est habilement repérée chez Proust mais son concept, lui, semble emprunté à Agamben et à son « maniérisme originel de l’être », transposé en « maniérisme de l’existence » (p. 20). Au risque d’un tête-à-queue bien dangereux, la valeur poétique et anthropologico-historique de ce terme est ainsi renvoyée à une définition philosophique et ontologique qui vient miner les efforts consentis par ailleurs pour construire une éthique et une politique fondées sur l’activité du langage. Ce qui explique pourquoi, dès le titre de l’essai Façons de lire, manières d’être et dans toute la suite du texte, « manière » est considéré, dans le droit fil de la pensée ontologique sur laquelle on s’appuie, comme totalement équivalent à « façon » ou à « modalité » : « Chacun expose et explore dans ce qu’il fait non seulement l’être qu’il est, mais toute une manière d’être, libérant un possible humain : une image du vivant et de son insertion dans les choses, une façon de s’avancer au dehors et d’en soutenir l’effort, des modalités expressives et des façons de se conduire qui sont par définition partageables et généralisables. » (p. 21, c’est moi qui souligne) Disparaît alors tout l’apport de la réflexion des artistes et écrivains depuis le XVIe siècle sur la notion de manière, au profit d’une notion de style que l’on sait par ailleurs intenable [2].
Le même flou touche les usages du terme rythme, qui fait pourtant l’objet d’une partie entière de l’essai : « Trouver son rythme ». Encore une fois Proust mais aussi Michaux, Ponge fournissent tout un ensemble d’observations capitales concernant le rythme d’un point de vue poétique – au sens de la poétique. Il s’agit alors de phrasé, d’effets d’ensemble, de configurations temporelles. Mais parfois le rythme signifie simplement l’ordre plus ou moins répétitif qui est donné à une succession de phénomènes, une alternance binaire de temps forts et faibles : « Sa manière d’être au piano régulait un rapport au temps et aux formes de la périodicité que Sartre ne trouvait pas dans le roman. » (p. 154). La plupart du temps, et l’on sent ici l’influence de Deleuze, « rythme » signifie variations de vitesse, transformations plus ou moins réglées du tempo : « Comme tout le monde, mais à sa manière, Sartre suivait donc en lui-même plusieurs tempos. » (p. 154) Plus loin : « Dans un aller-retour permanent de discordances et de rééquilibrages rythmiques, la poésie éprouve notre tempo intérieur. » (p. 159) Et en conclusion du chapitre sur le rythme : « La lecture engage des régimes de temporalisation très divers, faits de vitesses, de bifurcations et d’arrêts hétérogènes. » (p. 180) À la fois curiosité théorique et symptôme, on trouve enfin un emploi du mot rythme alliant acceptions métrique et deleuzienne : « Suivre un auteur dans sa phrase, c’est donc s’approprier son mode de figuration, lui emboîter le pas et faire sienne sa démarche, en modulant ce pas dans son propre tempo. » (p. 87) On est alors passé, sans avoir complètement rejeté le modèle traditionnel qui réapparaît, on le voit, à l’occasion, de la découverte d’une nouvelle réalité à une théorie philosophique qui offre bien peu de moyens pour penser les rythmes poétiques.
Des contradictions d’une stylistique pragmatique
Le second problème concerne le type d’approche choisi par Marielle Macé. Il me semble que cette approche est en partie grevée par une contradiction intérieure qui ne cesse de gêner son développement. D’un côté, elle place la stylistique au centre de son essai : sur le plan de l’analyse littéraire, elle cherche à identifier et comprendre des « styles de lecture » informés par des « styles d’écriture » ; de même, sur le plan éthique et politique, elle vise, à l’instar de Foucault, une « stylistique de l’existence ». Or, de l’autre, elle rejette simultanément les deux présupposés fondamentaux qui fondent ce paradigme : la définition du style comme un ensemble d’écarts par rapport aux normes de la langue et de la société ; les présupposés éthiques et politiques individualistes qui accompagnent celle-ci comme son ombre. Du coup, on ne voit pas bien pourquoi, dans ce cas, elle s’embarrasse encore d’un concept et d’un ensemble théorique qui, quoi qu’elle en ait et quoi qu’elle fasse pour lutter contre, pèsent de tout le poids de leur histoire plusieurs fois centenaire sur le moindre de ses énoncés. Il sera toujours difficile de parler d’« esthétique », de « stylistique » et de « dandysme », tout en expliquant qu’on ne conçoit pas ces notions dans les termes para-normatifs et individualistes traditionnels. On a aussi peu de chance d’arriver à se faire entendre que Foucault lorsqu’il s’est engagé au début des années 1980 dans la même voie sans issue – et toutes les chances, au contraire, d’être rattrapé et englobé par ce qu’on rejetait en première instance.
Marielle Macé croit, il est vrai, pouvoir renouveler le vieux paradigme stylistique de l’intérieur en lui injectant une bonne dose de pragmatique et de théorie de l’individuation [3]. Mais, au lieu de desserrer l’étau dualiste et individualiste du style, cette opération a plutôt tendance à amoindrir, selon un processus inverse, le tranchant de ces deux approches théoriques.
La pragmatique est en effet tirée en permanence vers une conception pragmatiste, d’origine peircienne, qui donne le primat à l’action, c’est-à-dire au seul jeu des forces considérées en dehors du langage. Ce fonds théorique explique que l’on puisse glisser sans trop de difficultés, au cours du livre, du souci de Ricœur pour les effets phénoménologiques de l’expérience des œuvres langagières à la vision prônée, au moins pendant un certain nombre d’années, par Deleuze et Foucault d’un cosmos d’énergies et de désirs, dans lequel le langage n’est que le simple champ d’expression des forces et des pratiques qu’elles suscitent. À chaque fois, on se focalise sur les actions et leurs effets en oubliant que ces actions et ces effets ne sont pas séparables du milieu langagier sans lequel ils ne pourraient avoir lieu. Une métaphysique pragmatiste diffuse permet ainsi d’effectuer la synthèse des inconciliables : « La notion esthétique de conduite permet justement de tenir ensemble une phénoménologie de l’expérience des œuvres et une pragmatique du rapport à soi. » (p. 15) Plus loin dans l’essai, au moment de la bascule d’un monde théorique dans l’autre : « Acquiescer en lisant à une conduite fait en revanche passer du registre de l’expérience à celui de la performance, d’une culture (phénoménologique) de la sensation à une culture (pragmatique ou constructiviste) de la simulation ; ce qu’on lit ne mène plus à affûter des perceptions ou des rythmes, mais à retourner la pratique de la modélisation de la littérature vers soi-même. » (p. 183-84)
L’approche de l’individuation, quant à elle, démarre comme le demandait Simondon, et Deleuze après lui, « par le milieu » ; elle remet tout d’abord en question les dualismes de l’individu et du social, du langage et de la vie ; puis elle oblique et revient sur ses pas. L’individuation se confond alors, et de plus en plus vers la fin de l’essai, avec un travail de l’individu sur lui-même, une recherche de conduite réfléchie, aux deux sens du terme : consciente de ce qu’elle fait et repliée vers un soi, dont on ne sait plus alors, en l’absence d’une théorie solide de la transsubjectivité qui est juste suggérée, s’il n’a pas été tout simplement toujours déjà là. Ce « soi » est d’abord l’objet d’une simple « invitation à essayer de nouvelles dispositions » : « L’expérience littéraire en tant que telle – la conduite dans les œuvres – se prolonge et se ressaisit ainsi en pragmatique du rapport à soi et au monde sensible : en invitation à essayer de nouvelles dispositions cognitives, un autre corps, un autre rythme, un autre “soi”. » (p. 101) Mais les choses se précisent rapidement, car il est aussi le sujet d’« une institution esthétique de soi » (p. 102), d’« un désir de se donner une forme temporelle » (p. 108). Plus loin, c’est lui qui « module son attitude dans le temps, se façonne dans et par les manières dont il se conduit dans la durée propre de sa lecture » (p. 160). Tout dépend finalement de sa « décision », « décision herméneutique du lecteur » (p. 229) mais aussi décision « autopoiétique » comme dans cette déclaration concernant Sartre : « La manière de se tenir dans cette successivité ou de refuser de le faire est une décision forte et première sur l’être. » (p. 178) Je reviendrai plus bas sur ce point à propos de Foucault.
Heurs et malheurs de la théorie de la refiguration
Cette contradiction interne et l’affaiblissement de la critique qu’elle entraîne expliquent que les critiques les plus justes se retournent à un certain moment de leur développement en leur contraire.
Marielle Macé fait, par exemple, dans la première partie de son ouvrage, avec justesse, le procès des conceptions sémiotiques et narratologiques de la lecture (p. 30). Les unes, dit-elle, outre qu’elles séparent la performance de lecture de la vie, font abusivement du lecteur un être entièrement assujetti au réseau composé par les renvois des signes les uns aux autres ; les autres, un personnage irréel qui rassemblerait toujours les éléments épars de sa vie suivant un modèle narratif impliquant nécessairement une directionnalité et une clôture finale. Ce qu’elle résume drôlement par une formule qui fait mouche : « Les narratologies ou les sémiotiques veulent figurer la lecture comme un cheminement clos sur lui-même, selon une sorte d’imaginaire ferroviaire. » (p. 137)
Quant à Ricœur, il a certes tenté de surmonter cet unilatéralisme en s’appuyant sur les ressources à la fois de la métaphore et du récit, mais dans la mesure où il privilégie encore la rétrospection, la totalisation et la suture au sein d’un récit de type traditionnel, il ne peut rendre compte ni du caractère immédiat et toujours en cours de l’appropriation du sens dans la lecture (p. 138-39), ni de l’ouverture, ni des discontinuités, des tensions mais aussi des échecs, qui sont essentiels à l’avancée de la vie (p. 159).
C’est pourquoi Marielle Macé propose de remettre au cœur de toute lecture le processus de refiguration que Ricœur place plutôt au terme du processus mimétique : « Ricœur aurait pu affirmer, à côté des formes d’une identité narrative, les voies de ce que j’appellerai bientôt une “identité stylistique”, par exemple d’une pensée des rythmes et des formations figurales du moi. Mais ce n’est que dans le cadre du récit qu’il a envisagé le retentissement de la lecture sur l’individu, sur les formes de cet individu. […] Seul le plan du récit emporte avec lui la question du soi et mène à l’identité ; comme si la narrativisation couvrait à elle seule toutes les modalités de la subjectivation. » (p. 156)
Elle ouvre alors au maximum la focale qu’elle utilise et fait du rythme et de la manière les concepts qui devraient permettre de surmonter l’aspect normatif la pensée ricœurienne. La refiguration de l’expérience doit être pensée non plus sur le modèle linéaire et totalisant du récit mais sur celui, multiple, proliférant et tendu du rythme : « Certains héritages philosophiques encouragent d’ailleurs cet élargissement des manières de la refiguration ; Merleau-Ponty ou Leroi-Gourhan aident par exemple à fonder l’individuation sur la question du rythme, sur la rythmicité fondamentale des pratiques individuelles, sur la qualification et la modulation rythmique de tous nos gestes. La rythmicité est un aspect essentiel de l’institution des sujets ; elle tourne le regard vers ce qui fait des formes éprouvées des forces de subjectivation mais aussi, et c’est tout un, de désubjectivation. » (p. 159) Marielle Macé s’approche ainsi très près des notions « d’eurythmie » et de « degré de rythmicité ».
Mais, dans la mesure où elle se confie entièrement à une stylistique et à une esthétique pragmatiste, dont le principe n’est pas le langage comme activité discursive poétique et signifiante mais l’action en elle-même, tous les exemples qu’elle donne de ces processus de refiguration laissent en fait le rythme de côté et s’en remettent in fine au sens et à la figure, définie ici traditionnellement par écart à une norme, que celle-ci soit la langue ou la morale sociale. Chez Bourdieu, dans sa lecture du poème « Automne malade » extrait d’Alcools d’Apollinaire, c’est le sens qui s’impose au lecteur – sens dont une paraphrase est censée expliquer les effets supposés : « Et que j’aime Ô saison que j’aime tes rumeurs / Les fruits tombant sans qu’on les cueille / Le vent et la forêt qui pleurent / Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille / Les feuilles / Qu’on foule / Un train / Qui roule / La vie / S’écoule. Écoulement de vie, décidément, au long d’une voie qui rappelle celle sur laquelle se tenait Sartre : hémorragie et transfusion, affaiblissement d’un rythme vital jusqu’à la mort de l’automne et du poème, injection froide et destinale faite au lecteur. » (p. 170) Le poème disparaît alors en tant que poème au profit d’une maxime d’action : « Bourdieu réévalue, grâce à Apollinaire et en l’éprouvant autrement en lui-même (en l’éprouvant “en beauté”, dans une forme augmentée de valeurs), toute sa théorie de l’amor fati, cette capacité désespérante des sujets sociaux à ajuster leurs espérances aux limites objectives de leur situation. » (p. 171) Chez Michaux, c’est l’écart à la grammaire qui trace les chemins de la lecture : « Tout le mouvement de la figuration du moi est ici [un poème de La Vie dans les plis] fait de désorientations et de réorientations dans le travail des qualifications grammaticales, dans le jeu des seuils catégoriels. » (p. 165)
Le rejet justifié des signes et des schémas narratifs, la belle idée d’une refiguration constante et généralisée « au-delà de la narrativité », l’invention d’une alternative rythmique, rebroussent finalement vers des positions tout à fait traditionnelles – ce que l’auteur appelle quelques pages plus loin « une conception de l’identité comme jeu systémique de différences, force d’écart » (p. 208). On s’attendait à une étude du phrasé, des effets d’ensemble et de configurations temporelles de la signifiance, mais ce que l’on voit arriver à leur place, c’est une simple stylistique comme on en connaît depuis longtemps.
Heurs et malheurs de la théorie de la préfiguration
Une autre mésaventure du même genre concerne les analyses consacrées dans la dernière partie de l’ouvrage à l’influence de la lecture sur la conduite de soi. Marielle Macé commence par une remise en question tout à fait bienvenue de toutes les conceptions unilatérales et déterministes de la mimesis : celles qui, à l’instar de René Girard, de Baudrillard et du premier Bourdieu, ne voient dans les processus d’imitation que des processus d’aliénation, comme celles, typiques de l’idéologie néo-libérale contemporaine, qui ne veulent en retenir que l’exercice d’une capacité indéfectible à se produire soi-même par son propre génie : « Sans doute est-ce aujourd’hui une tâche importante que de comprendre les ambivalences de l’imitation, pour la part de l’activité (la performativité du soi) et de l’aliénation (la facticité des identités) dans notre acquiescement à des modèles : chacun dispose en effet du pouvoir d’accepter ou de refuser ce qui s’empare de son désir, et éprouve fortement ce pouvoir ou cette impuissance à agir sur soi-même au cœur d’un assujettissement esthétique. » (p. 185)
Elle montre, en s’appuyant sur Barthes et sur Jacques Rancière, que les contraintes sémiotiques, symboliques et même poétiques, dans lesquelles nous nous débattons, sont également des ressources. La subjectivation s’entrelace avec l’assujettissement dans une torsade dont il n’est pas possible d’arracher un fil sans la détruire entièrement. Il y aurait donc quelque chose comme un « bovarysme des formes » qui expliquerait que nous soyons tout le temps dans un double rapport au donné et à ce qui nous arrive : « Éclairé […] par la tendance affective de toute lecture et les formes ordinaires de l’identification, le bovarysme pourrait redevenir la figure incontournable d’une psychologie de la littérature. Et pourquoi pas, d’une politique de la lecture […] C’est une capacité que Rancière veut révéler chez des lecteurs qu’on suppose trop vite, comme Emma, captifs et incapables de maîtriser la multiplicité des formes que l’âge esthétique disperse autour d’eux. » (p. 188-89)
De cela découle une profession de foi anti-dualiste et interactionniste (au sens épistémologique) aujourd’hui partagée par de plus en plus de monde : il nous faut « cesser de renvoyer dos-à-dos l’empathie et l’interprétation, le pâtir et l’agir, l’expérience affective et la distance herméneutique ; et sur cette base, […] prendre acte, dans les rencontres individuelles avec les formes ou les destins d’autrui, d’un travail permanent entre plusieurs rapports à soi-même, entre plusieurs façons de rapporter les modèles à sa propre subjectivité » (p. 190). Plus loin, à propos de Foucault : « Le pouvoir et la liberté, ici, ne sont pas dressés face à face, mais pris dans une interdépendance dont la situation de lecture pourrait bien être l’allégorie. » (p. 204) C’est cet anti-dualisme interactionniste qu’elle appelle, de manière peu rigoureuse mais courante de nos jours, « la dialectique de donné et de ressaisie qui est le moteur de toute individuation » (p. 217).
Marielle Macé remarque alors, avec beaucoup de justesse, que cette question, posée du point de vue des images et de l’imaginaire par Lacan, se pose encore plus « dans notre rapport à nos propres mots » (p. 185). Il s’agit, dit-elle, « de comprendre ce que c’est que “vivre” dans une phrase ou dans un poème, et en quoi il y a effectivement pour chacun de nous, dans la réappropriation décidée d’un rapport au langage, de grandes ressources de subjectivation » (p. 185). Plus loin : « Ce bovarysme, on le voit, est un bovarysme des formes de langage, non des destinées ou des personnalités. C’est la forme du dire qui conquiert massivement et conduit le désir. » (p. 194) L’expérience littéraire devient « créatrice de formes de vie » (p. 194). Il nous faut donc comprendre comment fonctionne « ce que Barthes nous a aidés à reconnaître comme un “plein”, un trop-plein, une puissance qui affecte et saisit le lecteur, une force contraignante, coûteuse et déphasante, une altérité dont il faut parvenir à faire son “propre”. » (p. 242)
Pour décrire ces phénomènes croisés d’influence et d’appropriation qui vont déterminer les pratiques de soi du lecteur, elle introduit le concept de préfiguration, qui constitue, dans cette dernière partie du livre, le pendant de celui de refiguration que, l’on a déjà rencontré dans l’analyse phénoménologique des transformations du moi. En s’appuyant aussi bien sur Proust que sur Auerbach et Michel Deguy, Marielle Macé montre qu’un grand nombre des formes d’appropriation et d’usage des textes relèvent d’une logique non pas de la figure et de l’écart, comme précédemment, mais de la figura au sens de l’herméneutique biblique chrétienne. La transposition par le lecteur d’un texte dans sa vie revient souvent pour lui à donner à certaines de ses « propositions » le sens d’allégories anticipatrices ou d’auto-prophéties : « On passe son temps, dans la lecture, à regarder les œuvres comme des propositions allégoriques qui étendent leurs possibles et leur actualité future sur le monde, et à s’y glisser soi-même en biais pour vivre autrement et devenir à son tour figurable, dans un trope généralisé. » (p. 224) De ce point de vue, lire un texte littéraire – et on ne peut que lui donner raison –, c’est participer à « la circulation d’un talent figural commun aux livres et aux individus, une capacité à imaginer autrement et à s’imaginer autre. » (p. 224) Le texte littéraire se présente comme la préfiguration ou la prophétie d’une vie : « Un sens était à vivre. » (p. 222)
Or, comme précédemment, les exemples qui viennent appuyer ces déclarations ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. Certes, elle épingle au passage, avec autant de délicatesse que de pertinence, le formalisme syntaxique de Vincent Descombes : « Les phrases littéraires sont héritées, admirées, prises dans le temps et dans un rapport insistant de désirs et de forces, qui coloreraient un peu autrement les belles réflexions grammaticales de Vincent Descombes et de son Complément de sujet sur les enjeux de la syntaxe du “soi” et la grammaire du rapport réflexif à soi-même. » (p. 203) Mais ce qu’elle propose pour sa part n’est pas moins formel et limitatif.
Tout d’abord, on note que, contrairement à ce qui a été au moins tenté dans la première partie avec la refiguration, la logique de la préfiguration n’est pas ici, comme on aurait pu l’espérer, reliée au rythme. Ne serait-ce que par souci de symétrie, on aurait pu imaginer que Marielle Macé avance dans cette direction. Les raisons qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas fait sont multiples. J’en citerai trois qui me semblent les plus vraisemblables.
La première est, de toute évidence, son identification du rythme à une question phénoménologique. Bien que le rythme soit très présent chez Foucault, au moins depuis Surveiller et Punir [4], il ne peut pas y être reconnu d’un point de vue phénoménologique, même mâtinée de deleuzisme. D’où l’impossibilité de relier les deux pôles de la refiguration du moi et de la préfiguration du soi sous son égide.
Une autre raison tient à ce que la parole est considérée comme indépendante de la question de la voix. D’un côté, on lit des énoncés de ce genre : « Le devenir-autre (se-voir-autre, devenir-plus) se joue ici dans la logique commune de la parole. C’est la dynamique ordinaire du sens qui nous fait nous projeter dans une phrase et nous ré-instaurer en elle. » (p. 215) De même, chez Jacques Rancière, il s’agit de comprendre « l’événement individuel d’une parole » (p. 237). Mais, de l’autre, on trouve d’autres types d’énoncés qui limitent cette parole à la simple énonciation d’un sens, séparée de son support signifiant : « En vérité, ce rephrasage de Baudelaire n’est pas essentiellement une réénonciation ; il touche moins à la question de la voix qu’au dégagement complexe d’une idée de forme, c’est-à-dire à la compréhension efficace de quelque chose de généralisable. » (p. 241)
La dernière raison tient aux références théoriques mobilisées dans cette théorie de la préfiguration. Pour passer au dessous de la syntaxe et de la grammaire elles-mêmes et faire mentir Descombes, plutôt que d’emprunter la voie de la poétique du rythme, Marielle Macé préfère la voie des nietzschéismes des années 1970, qui, après avoir « émietté le tout » – citation du Gai savoir très en vogue à l’époque –, pensent ainsi pouvoir retrouver « l’émotion », « la vie », « la germination » (Barthes III, 834, cité p. 200).
On ne peut accuser Marielle Macé de tomber complètement dans les illusions courantes à cette époque, qui croyait se débarrasser du signe et du structuralisme, parce qu’elle brûlait avec l’enthousiasme des convertis récents ce qu’elle avait adoré et avait recours à une métaphysique vitaliste souvent simpliste. Pour Barthes, la citation était en fin de compte toujours un « fragment de code » : « Ici règne la citation, la pincée d’écriture, le fragment de code. » (p. 217) Ou encore un morceau de « langue » : « Les citations, donc, sont les données de cette langue d’emprunt que parle notre intériorité. » (p. 218) Où l’on voit que le nietzschéisme ne libérait pas de toute référence au structuralisme.
De ce nietzschéisme diffus Marielle Macé retient malgré tout, pour construire sa théorie de la lecture, une conception du discours comme succession de phrases ou d’énoncés isolables les uns des autres. Alors que la refiguration englobait tout le texte – ce qui permettait de passer du discours au sens de la linguistique au discours à celui de la poétique –, la préfiguration le découpe en morceaux dépareillés, pour lesquels la question rythmique n’est évidemment plus pertinente : « Ce bovarysme des formes a trouvé chez Barthes son foyer précis […] ; ce foyer, c’est la Phrase, qu’il conçoit en bloc, après Flaubert et Mallarmé, comme une “unité de forme” et une “unité de vie”. » (p. 194) La phrase serait, selon elle, « le lieu où ce lecteur trouve son plaisir, l’échelle sensible à laquelle il se situe (ce qu’il [Barthes] retient de ses lectures, ce sont des “idées-phrases” ou des “phrases-chants”) » (p. 195). Elle retrouve un peu plus loin le même présupposé chez Jacques Rancière : « Le pensée littéraire de Rancière en particulier vise directement une pratique d’émancipation des individus, et c’est précisément l’échelle de la phrase (“la phrase égalitaire”) qui autorise chez lui cet enjeu. » (p. 236)
La conséquence immédiate de cette conception est particulièrement significative. Alors qu’elle était jusque-là liée sinon identifiée au rythme, la manière n’est plus qu’un « air syntaxique » et une « “allure” grammaticale » (p. 198). Où un modèle pourtant rejeté en première instance fait retour. Mais la conséquence à long terme ne l’est pas moins. Selon cette conception phrastique du discours, l’expérience qui se produit au cours de la lecture pourrait se ramener à une série d’effets citationnels : « Aux yeux de Barthes la phrase prouve, particulièrement lorsqu’elle est brève, qu’elle frappe une idée en maxime et qu’elle fonctionne, par conséquent, comme “un inducteur de vérité”, une forme qui conduit le sujet vers son propre avenir. » (p. 215) Plus loin, la même idée : « Les phrases sont en effet moins des objets que des directions et des appels, les promesses d’une pratique à venir ; elles sont à citer. La citation est la réponse la plus active, la plus simple à cette vocation de formes ; c’est l’évidence pratique d’une “vie en forme de phrase”. » (p. 216)
Or, cette réduction du texte lu à un ensemble de citations éventuelles entraîne au moins deux conséquences très dommageables.
La première concerne le primat qui est alors donné au discontinu et à la dispersion. Comme la citation implique de facto une extraction qui l’arrache à son contexte, cette redéfinition brise l’organisation dynamique signifiante du texte. Le lecteur Barthes, nous rappelle Marielle Macé, se surprend « à transporter spontanément dans les circonstances de la vie des bribes de phrases, des formulations issues spontanément du texte balzacien […] j’écris la vie (il est vrai dans ma tête) à travers ces formules héritées d’une écriture antérieure » (Barthes, II, 1269, citée p. 218). Le sujet poétique apparaît ainsi « dispersé » dans les phrases ou dans des morceaux de phrase : « Vivre avec l’écrivain conduit à prélever des détails, des phrases dont seule la discontinuité (celle qu’imprime l’acte de lecture) autorise la projectibilité. S’il y a un sujet à suivre dans une œuvre, il faut qu’il soit dispersé, pour que je puisse, par morceaux, m’individuer dans une coexistence (dans un enfermement prolongé) avec lui. » (p. 234) Marielle Macé cite également ici Jacques Rancière selon lequel la littérature moderne reposerait précisément « sur cette structure de disponibilité fragmentaire : parole à la fois “bavarde” et “muette” (parole sans leçon déterminée, orpheline, sans père vivant pour en fixer le sens et la défendre), proposition de phrases sans destinataires privilégiés, fragments de langage errants que des corps sans propriété, sans destination eux aussi, s’affairent à accueillir et à détourner, se laissant activement dévier des circuits déterminés, se laissant conduire là où sera leur liberté, là où leur liberté se prouvera. » (p. 236)
Outre le caractère très contestable en soi de la notion de « fragment de langage errant » (ce que l’on considère comme un « fragment langagier » n’est-il pas, toujours et nécessairement, lié à la totalité du langage ou au moins à la totalité d’une œuvre ?), il faut ici souligner la dérive subie par la pensée critique depuis la fin des années 1960. Les analyses de Marielle Macé montrent très bien, même si c’est involontaire, comment ce mouvement de déconstruction anti-structuraliste – qui avait encore sa nécessité intellectuelle, éthique et politique, en 1969 dans L’Archéologie du savoir et aussi chez Barthes – s’est finalement figé dans les années 1990, à travers sa diffusion dans le corps des enseignants d’université et des chercheurs rémunérés, au moment même où les derniers vestiges du monde systémique, administré et disciplinaire étaient en train de s’effondrer. Alors qu’il était impulsé à l’origine par une véritable force critique, ce mouvement s’est transformé en une doctrine considérée comme de portée universelle, indépendamment du contexte scientifique, social et politique dans lequel elle est projetée. Aux usagers de cette doctrine, on se permettra de rappeler simplement que le monde à la fois fluide et fracturé dans lequel nous vivons depuis la mondialisation n’a plus rien à voir avec le monde systémique et relativement ordonné des Trente Glorieuses et qu’il faudrait peut-être qu’ils y adaptent leurs outils.
À ce primat du discontinu s’ajoute, deuxième difficulté, un primat de l’énoncé. Les effets citationnels dépendent du seul signifié et mettent ainsi hors jeu l’énonciation et la signifiance. Les citations sont, comme dit Barthes, des « fragments d’intelligible », des « formules » : « Vivre avec eux [les écrivains] ne veut pas dire suivre le programme qu’ils ont tracé et opérer le tout qu’ils ont représentés ; cela signifie, plus silencieusement : “faire passer dans notre quotidienneté des fragments d’intelligible (des ‘formules’) issues du texte admiré.” » (Barthes, II, 1044, cité p. 234) L’appropriation consisterait donc simplement à remonter des phrases dépareillées, comme chez Jacques Rancière chez qui « elle est une opération de réénonciation et foncièrement un montage de phrases : des discours sont extraits, projetés dans un nouveau contexte, conjugués au présent du sujet, attelés à d’autres phrases pour composer une vocalisation individuelle qui est la trame même du processus de subjectivation. » (p. 237)
Alors qu’elles étaient présentées comme des processus, certes d’intensité variable mais continus, l’individuation et la subjectivation sont désormais vues comme des agglutinations de traits rencontrés et empruntés au hasard : « Que veut dire “vie”, ici ? Non pas la forme globale progressivement prise par une aventure individuelle, mais l’énergie perpétuelle d’une expression, d’un désir. » (p. 203) Plus loin, à propos de Tarde : « L’individu est singulièrement vécu comme une sorte de montage ; sa particularité n’est pas première, elle se construit au fur et à mesure de la capture des influences : il imite des modèles hétérogènes (Deleuze s’en souviendra), et il est le seul à combiner tel ensemble d’imitations. » (p. 206)
Ainsi la pensée connaît-elle ici aussi une sorte de rebroussement. La critique justifiée des conceptions unilatérales et déterministes, la stratégie anti-dualiste interactionniste, la volonté de comprendre comment une forme littéraire peut être créatrice de forme de vie, l’idée très juste de la préfiguration allégorique, tout cela s’épuise au profit de positions qui ne sont pas si lointaines de celles que l’on condamnait au départ. Du côté du texte, on s’attendait à une étude des effets prophétiques et allégoriques de la signifiance, prise à tous les niveaux langagiers, de la plus petite (le signifiant) à la plus grande unité (le texte), une étude qui montre le rôle déterminant de l’organisation de l’énonciation, bref du rythme, mais c’est à une stylistique de la phrase et de l’énoncé coupée de toute dimension pragmatique que s’en remet finalement Marielle Macé. Du côté du lecteur, on espérait une théorie de l’individuation qui, comme dans la première partie avec les notions de « forme-maîtresse » et de « manière », rejetant d’un même geste les visions purement continuistes et les visions purement discontinuistes, fasse place aux organisations du mouvant, aux manières spécifiques de fluer. Mais la théorie choisie – et avec elle l’éthique et la politique visées – reviennent à donner un primat au bricolage, au hasard et à l’hétérogène.
Ouvertures
Marielle Macé semble, quand même, avoir eu peur des conséquences de son propre nietzschéisme. C’est pourquoi on trouve aussi vers la fin du livre quelques propositions alternatives dont il est important de bien mesurer les potentialités critiques.
Du côté du texte, quelques pages après avoir repris à son compte l’héritage néo-nietzschéen de Barthes et de Jacques Rancière, elle remet en question le primat de la dispersion des énoncés au nom d’une puissance d’individuation et de subjectivation de nature proprement poétique. Les pensées des années 1970, dit-elle, ont « justement thématisé le “devenir”, le “désir” et la “puissance” contre les “positions d’être”. On peut insister avec elle sur la souveraineté de ce désir, et compter sur l’évidence émancipatrice des pratiques esthétiques. Mais on peut aussi, se tournant plutôt vers ce qui l’aimante, prendre acte de la puissance de ces objets qui appellent le désir, reconnaître leur capacité déterminante de guidage. » (p. 243) De Proust – d’où provient, on le voit, beaucoup de ce qui est le plus productif dans cet essai –, elle reprend alors l’idée du caractère déterminant pour la réception à la fois du « phrasé » et des « effets d’ensemble » propres à une « œuvre » : « Marcel sentait obscurément ce que telle ou telle phrase “voulait” de lui : faire l’expérience d’une œuvre, c’était accompagner la formation d’un phrasé qui pourtant le contestait. » (p. 245) Phrasé, dont, au passage, on voit ici clairement le lien avec « la nouveauté, parfaitement cohérente, de rapports que je n’avais pas l’habitude de suivre. » (Proust, cité p. 89)
Certes, Marielle Macé ne semble pas se rendre compte que l’un et l’autre remettent en question le primat attribué par ailleurs à la phrase, à l’énoncé et au signifié, et elle ne reconnaît pas non plus ici la puissance du rythme signifiant. Comme on l’a vu plus haut, le rythme n’est à ses yeux qu’une organisation de la durée intime, une variation de ses vitesses. C’est un principe phénoménologique avant d’être un principe poétique : « Toute phrase se tient d’une manière particulière dans le temps, elle occupe un certain volume, impose une certaine vitesse, et organise pour nous une configuration inédite de la durée, en nous invitant à adopter son rythme et sa manière d’être dans le temps. » (p. 87) Mais on ne saurait sous-estimer l’importance de ce qui est ici introduit sotto voce : une prise en compte, fondée sur l’expérience littéraire, de la dynamique organisée de la signifiance.
La meilleure preuve de la fécondité de ces remarques est qu’elles entraînent l’introduction, du côté du lecteur, d’une autre conception de l’individuation, que Marielle Macé repère, elle aussi, chez Proust. Loin d’être un bricolage ou un montage de phrases, d’énoncés et de signifiés, l’individuation apparaît ici comme une manière d’avancer dans le langage, d’organiser le discours et l’énonciation, de faire sonner et résonner les signifiants : « De la parole à la comédie sociale, on voit bien des personnages se faire une manière à partir de leurs lectures. Mme de Cambremer forge par exemple son propre jeu, celui des adjectifs, dont elle use d’une façon bien à elle, mais en partie imitée. […] “C’était l’époque où les gens bien élevés observaient la règle d’être aimables et celle dite des trois adjectifs. Mme de Cambremer les combinait toutes les deux. Un adjectif louangeux ne lui suffisait pas, elle le faisait suivre (après un petit tiret) d’un second, puis (après un deuxième tiret) d’un troisième. Mais ce qui lui était particulier, c’est que, contrairement au but social et littéraire qu’elle se proposait, la succession des trois épithètes revêtait, dans les billets de Mme de Cambremer, l’aspect non d’une progression, mais d’un diminuendo.” » (p. 248)
Il est vrai, qu’une fois encore, le cadre théorique choisi empêche d’aller plus loin, ici en direction d’une théorie rythmique de l’individuation – et au-delà de la subjectivation – qui embrasse l’activité non seulement des corps, mais aussi du langage et du social. Pour rendre compte des phénomènes décrits par Proust, Marielle Macé convoque de manière assez judicieuse la notion d’« éthopoièse » élaborée par le dernier Foucault : « La dimension éthopoiétique du sujet est définie par la trame des actes accomplis et des postures corporelles (et non par des contenus ou des événements identifiants qu’une confession, par exemple, révélerait.) […] En travaillant à ce rapport qui le lie à lui-même, en travaillant à sa propre “manière”, l’individu se produit, se transforme, et se restitue à lui-même son “actualité”. » (p. 246)
Mais dans la mesure où le rôle très limité qui est donné à cette époque au langage par Foucault n’est pas mis en évidence, où le point de vue stylistique adopté ne permet en aucune façon de questionner le rôle joué chez lui précisément par la stylistique, et où, enfin, ces travaux des années 1980 sur l’éthopoièse sont, comme chez la quasi-totalité des foucaldiens aujourd’hui, dissociés de ses recherches sur les rythmes corporels et sociaux du milieu des années 1970, la question de l’invention d’une « manière propre », c’est-à-dire d’un « rythme propre » ou d’un « idiorrythme » – cette question qui était celle de Barthes dans les mêmes années –, est réduite à une simple mise en forme de l’activité corporelle et éventuellement sociale : « La connaissance de soi n’y est qu’un aspect d’un plus vaste “souci de soi” fait d’attitudes, de conduites et d’applications concrètes, qui déplace (comme Baudelaire) l’identité vers le geste, vers une certaine manière de se tenir dans le monde. » (p. 246)
Pire encore, cette mise en forme est vue comme une « stylisation ». Par quoi il faut entendre au mieux faire de sa vie « une espèce d’œuvre » (p. 247), devenir le « poète de soi-même » (p. 254), mais aussi, et c’est bien différent, adopter « le “dandysme moral” présent chez Baudelaire et chez Nietzsche » (p. 251). On glisse alors d’une éthique impliquant l’ouverture et le risque de la pratique artistique à une éthique de distinction sociale, fondée qui plus est sur un travail intentionnel et conscient.
Ce que l’on soupçonnait déjà depuis quelque temps trouve alors sa confirmation. Cette « stylistique du soi », pourtant explicitement développée selon une stratégie anti-dualiste, une volonté de penser « à partir du milieu » et des références puisées chez Simondon, Deleuze ou Foucault, se conclut par un éloge de la singularité dont le collectif est totalement absent. Ce qui apparaissait déjà au cours de l’essai, dont les descriptions se centraient sur les parcours de lecture des singuliers sans les relier jamais à un contexte social, se cristallise dans la figure du dandy. Cette ultime victoire du dualisme montre, s’il le fallait encore, la nécessité d’abandonner la stylistique et de passer à une poétique.
Cette incapacité à distinguer ce qui, chez Foucault, reste productif et ce qui ne l’est déjà plus, explique, à mon avis, la nécessité ressentie par Marielle Macé de réinscrire finalement celui-ci dans un cadre stoïcien (p. 204 sq., 247 et 251), que l’intéressé rejetait pourtant explicitement comme on le voit dans son débat avec Pierre Hadot. Elle sent bien que le point de vue prônant la dispersion des énoncés et la construction esthétique de soi n’est pas tenable, mais, en l’absence d’une théorie lui permettant de penser à la fois l’ouverture et l’organisation de l’expérience, l’universalité et l’historicité radicale de l’individuation et de la subjectivation, elle ne peut que le réinscrire dans un ordre rationnel cosmique, dont Foucault disait précisément à Hadot qu’il ne pouvait plus être utilisé aujourd’hui comme critère moral ou scientifique.
Linguistique et poétique : les deux points aveugles de la stylistique
Pour conclure cette discussion, je voudrais dire quelques mots sur les blancs théoriques qui trouent l’argumentation de cet essai et l’oblige bien souvent à prendre des chemins contournés qui ne mènent nulle part. On ne trouvera rien dans Façons de lire, manières d’être concernant les apports, pourtant anciens et conséquents, de la linguistique et de la poétique aux questions qui y sont traitées.
Ces blancs dans la réflexion vont, à mon avis, bien au-delà d’un problème de formation et de documentation des chercheurs. Ils reflètent l’extrême difficulté si ce n’est l’impossibilité, quand on adopte un point de vue stylistique et pragmatiste, à donner à ces deux disciplines les places qui leur reviennent. En 1960, Jakobson voulait croire que ce problème était voué à disparaître rapidement : « Chacun de nous ici, cependant, se rend compte vraiment qu’un linguiste sourd à la fonction poétique du langage et un spécialiste de littérature indifférent aux problèmes linguistiques et non versé dans les méthodes linguistiques sont de manière égale de flagrants anachronismes. [5] » Cinquante ans après, on s’aperçoit que ces espoirs étaient prématurés et que ce qui semblait évident aux défricheurs des années 1960 ne l’est toujours pas à ceux des années 2010. La stylistique, même cette stylistique contestée de l’intérieur que défend Marielle Macé, continue à constituer un obstacle épistémologique qui bloque la pensée.
Ces blancs reflètent aussi le rôle disproportionné et finalement assez confus qui est du coup donné à la philosophie. Dans la mesure où l’on veut conserver le cadre et le vocabulaire de la stylistique traditionnelle, tout en en contestant certaines prémisses, il n’est plus possible de se réclamer de Bally, de Spitzer ou de leurs successeurs – qui sont eux aussi, on peut le remarquer, totalement absents de l’essai. Mais comme on ignore les apports de la linguistique et de la poétique, ce sont donc des philosophes qui fourniront les références théoriques manquantes, et cela selon un parcours dans le livre qui est loin d’être neutre – je laisse de côté les références naturalistes cognitivistes qui viennent de-ci de-là ajouter encore à la confusion mais ne semblent pas déterminantes. Après avoir esquissé un cadre ontologique et phénoménologique en s’appuyant sur Heidegger, Agamben, Merleau-Ponty et Ricœur, Marielle Macé dessine dans l’espace ainsi délimité quelques dispositifs inspirés de Simondon et Leroi-Gourhan, puis recouvre le tout, tableau et cadre compris, d’une épaisse couche de pensée de la dispersion et du désir puisée chez Barthes, Jacques Rancière, Deleuze et Foucault. Or, non seulement on peut douter, dans le premier cas, de la compatibilité des pensées phénoménologiques de l’ego et des pensées ontologiques, violemment opposées à tout point de vue fondé sur le primat du sujet, mais il semble bien difficile de mettre en continuité et les unes et les autres, avec des philosophies de l’individuation et de la subjectivation qui, pour leur part, ont toujours refusé de considérer l’historicité radicale des êtres humains d’un point de vue onto- ou phénoméno-logique – et la modernité comme une décadence. Ces appuis successifs sur des philosophies incompatibles aboutissent finalement à une conception éclectique et passablement contradictoire.
Ces blancs me semblent, enfin, refléter un positionnement intellectuel problématique. Certes, personne n’ignore l’histoire mouvementée du champ des études littéraires depuis les années 1960, les luttes et les incompréhensions, le mépris et les rancœurs aussi, les dominations institutionnelles et les dérives sectaires. Il est quand même étonnant de constater qu’une spécialiste formée par l’une de nos meilleures écoles, membre d’un centre de recherche de réputation internationale, jeune qui plus est, reproduise si fidèlement et si sagement une grande partie des divisions et des exclusions qui ont empoisonné le champ de ces études depuis plusieurs décennies. Voici quelqu’un dont les travaux portent sur les notions de manière et de rythme, sur la pragmatique de l’écriture et de la lecture, sur la subjectivation et l’individuation par les pratiques du langage, sur l’éthique et la politique qui leur sont liées, mais qui semble ignorer la plus grande partie de ceux qui, depuis longtemps, ont affronté ces questions. Benveniste est cité rapidement pour son article sur la notion de rythme en Grèce ancienne [6]. Meschonnic reste dans ses Enfers. Rien, pas une ligne, pas une notule, pour en signaler ne serait-ce que l’existence. Quant aux recherches plus récentes concernant ces notions et ces problèmes, elles sont tout simplement ignorées.
Du point de vue du champ stylistique où elle se place, Marielle Macé apporte quelques propositions nouvelles. Elle est loin d’une simple application des modèles traditionnels et elle y introduit un point de vue pragmatiste qui n’y avait pas encore cours. Elle apporte surtout une somme d’exemples et d’analyses d’expériences de lecture tout à fait remarquable. Mais on aurait aimé qu’elle aille un peu plus loin et se frotte aussi aux réflexions qui ont déjà accompli ce mouvement hors de la stylistique et hors de la philosophie. Qu’elle s’affronte à des pensées vraiment autres, comme elle aime à le faire avec les textes littéraires, au lieu de simplement contester les représentations établies au sein de son alma mater intellectuelle en utilisant des pensées autrefois critiques et aujourd’hui en voie de domestication académique.
Certains trouveront peut-être ma lecture trop sévère, d’autres y verront, au contraire, et ils auront raison, la preuve d’un très grand intérêt pour une pensée dont on espère qu’elle continuera à explorer les terres inconnues de la manière et du rythme. En dépit de toutes les difficultés que j’ai pointées tout en essayant de les ex-pliquer de mon mieux, il me semble que Marielle Macé apporte dans son essai suffisamment de matériaux neufs, ouvre suffisamment de pistes nouvelles, pour que celui-ci soit assuré de rester à l’avenir comme une étape importante dans les transformations scientifiques en cours.